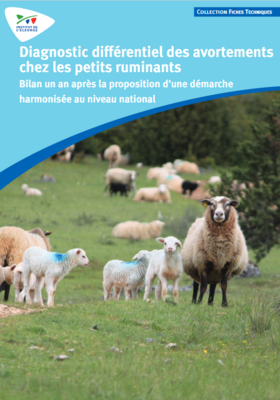Diagnostic différentiel des avortements chez les petits ruminants
Des actions synergiques et convergentes
Depuis plusieurs années, un ensemble de réflexions ont été engagées sur la thématique des avortements. Pour les petits ruminants, elles ont notamment concerné la définition réglementaire des avortements, les critères d'alerte en la matière ou encore les modalités de surveillance de maladies abortives dites "d’intérêt d’état" (brucellose, fièvre Q et fièvre de la vallée du Rift).
Un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q, a été déployé dans un réseau d’une dizaine de départements (Arrêté du 13 août 2012 relatif à la constitution d’un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q).
Parallèlement, des démarches harmonisées de diagnostic différentiel des avortements sont développées aussi bien chez les bovins (animation des travaux par GDS France) que chez les petits ruminants (animation par l'Institut de l'Elevage au sein de l'UMT Santé des Petits ruminants), de manière à améliorer le taux d'élucidation des causes d'épisodes abortifs et de pouvoir apporter des mesures concrètes en élevage.
Sur le plan épidémiologique enfin, la thématique des avortements a été retenue par la Plateforme Epidémiosurveillance en Santé Animale.
Une démarche collaborative
Les travaux sont engagés de manière collaborative au sein d'un groupe de travail animé par l'Institut de l'Elevage et l'ENVT au sein de l'UMT Santé des Petits Ruminants. Ils s'appuient sur :
- un partenariat national : GDS France, SNGTV, Races de France, ADILVA,
- un partenariat régional et départemental: FRGDS Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées, GDS 04, GDS 12, GDS 41, GDS 64, GDS Limousin - FRGTV Midi-Pyrénées - Laboratoires d'analyses 05, 58, 64, 79,
- une expertise scientifique et technique: Anses Niort, Alfort, Sophia Antipolis et ENVT.
Ce groupe pourra évoluer et s'élargir selon les besoins aussi bien scientifiques que de terrain au fur et à mesure de l'évolution de la démarche diagnostique et de l'intégration de maladies abortives de deuxième voire troisième intentions.
Ces travaux concernent :
- la définition des critères d'alerte pour la mise en œuvre du diagnostic différentiel,
- la définition d'un socle de maladies de première intention,
- la proposition d'une démarche logique, du recueil des commémoratifs et de l'examen clinique au choix des prélèvements et analyses à réaliser,
- l'intégration progressive de maladies de deuxième ou troisième intentions et la révision de la démarche initiale en fonction des résultats obtenus et des attentes formulées sur le terrain.
Travaux conduits dans le cadre de l'UMT Santé des Petits Ruminants
Les principes de la démarche diagnostique ont été présentés lors de la journée de restitution sur les avortements organisée conjointement par GDS France et par la SNGTV le 11 Janvier 2013. Retrouvez le diaporama présentant les principes de la démarche diagnostique.
Une plaquette a également été réalisée pour rappeler de manière synthétique quelles sont les mesures générales à prendre et les comportements à adopter en cas d'épisodes abortifs.
Par ailleurs, les documents issus du groupe de travail comportent :
- la présentation de la démarche diagnostique incluant des arbres décisionnels pour les maladies de première intention,
- des fiches de conseils pour la réalisation des prélèvements (écouvillonnage vaginal, prélèvement du contenu stomacal, d'encéphale, d'organes) et leur acheminement,
- des fiches synthétiques par maladie abortive (fièvre Q, chlamydiose, toxoplasmose, Border disease, salmonellose ).
A l'issue d'un an de mise en place de la démarche diagnostique dans un cadre d'étude (projet conduit par la FRGDS Midi-Pyrénées avec l'appui financier du conseil régional), de premiers résultats ont été diffusés. Ils permettent aujourd'hui de soulever de nouvelles questions aussi bien sur le plan scientifique, que logistique et devraient permettre de faire évoluer le diagnostic des pathologies abortives.
Ils sont présentés dans une plaquette disponible en téléchargement.